
Portrait du romancier Emile Zola
TRIBUNE. L’Empire colonial français était en fait très mal connu… des Français eux-mêmes. L’historien Alain Ruscio s’est penché sur les plus belles perles de nos concitoyens depuis le XVIIIème siècle.
Emile Zola qui confond le Maroc et la Tunisie, Paul Claudel qui situe l’Egypte en Asie, Cayenne décrite comme une île du Pacifique, le Maghreb placé à côté du Tonkin, Roland au clairon devenu héros de la conquête de l’Algérie, deux français sur dix incapables de citer le nom d’une colonie après-guerre… L’historien Alain Ruscio s’est penché sur les connaissances des métropolitains en matière de colonies du temps de l’Empire français. Son verdict est sans appel. Les Français ne savaient en fait que très peu de choses.
Un historien de la littérature constate qu’au XVIIIème siècle « on distinguait mal l’Arabe du Turc, et plus d’un Français put croire de bonne foi que le temple de La Mecque se dressait aussi près du sérail de Constantinople que la Sainte-Chapelle l’était du Louvre » (Pierre Martino, Les Arabes dans la comédie et le roman du XVIIIème siècle, 1905).
Au XIXème siècle, guère de progrès : « Des populations entières, on peut même dire toutes celles de nos campagnes, se succèdent sans avoir la moindre notion des rivages lointains où de courageux compatriotes prolongeraient pour ainsi dire la France, sans savoir le nom de nos Antilles, du Sénégal, de nos récentes colonies du Pacifique, de la Cochinchine, du Mexique, de Madagascar qui est encore à faire, seront moins impopulaires en France si on savait mieux parmi nous de quel pays s’agit-il, et si par conséquent instruit de leurs ressources et des avantages de leur situation, on se sentait plus apte à en profiter » (Maurice La Chesnais, Revue du monde colonial américain et asiatique, avril-juin 1864) .
Ernest Feydeau, le père du dramaturge, visite à cette époque l’Algérie. Il déplore : « Pour la plupart des habitants de l’Europe, l’Algérie est un peu moins connue que la Chine » (Alger, 1862) .
Un pilier du parti colonial (il est vrai alors en gestation) constate, amer : « Les colonies françaises sont presque inconnues en France ! Combien peu de personnes savent même le nombre de nos colonies ! Et sur le détail de leur géographie, de leur histoire, de leurs productions, de leur commerce, de leur administration, l’ignorance est plus grande encore. Le malheur est que, dans nos collèges, on ne s’occupe pas plus de l’étude de nos colonies que si elles n’existaient pas, malgré le haut intérêt qui s’y rattache à tous les points de vue » (J. Rambosson, Les colonies françaises, 1868).
« Qui de nous, après avoir terminé ses études et obtenu le diplôme de bachelier, était bien sûr, il y a dix ans, de pouvoir énumérer toutes les colonies françaises ? » (J.-T. Coffin, Des colonies et de l’Afrique centrale, 1879) .
« Sur mille citoyens, il n’y en a peut-être pas deux qui sachent au juste dans quel but, dans quel intérêt, on se jette en ces aventures, et pourquoi l’on s’y obstine. Les copieuses explications de la presse, les discussions cicéroniennes du Parlement n’instruisent à cet égard que le très petit nombre. À l’heure qu’il est, vous rencontrerez beaucoup d’esprits -je parle des plus attentifs » qui n’ont encore rien compris aux causes fort obscures, du reste, et fort embrouillées de l’expédition de Madagascar » (François Coppée, Guerre lointaine, 29 novembre 1894) .
« Des endroits où l’on envoie les mauvais sujets pour les faire manger par les anthropophages »
Adolphe Messimy, Saint-Cyrien, député, puis sénateur (radical), rapporteur du budget des Colonies, se fit une spécialité de dénoncer la faible part de la question coloniale dans l’enseignement en métropole. En 1911, son interpellation au ministre fait peut-être sourire certains : « La plupart des élèves se figurent que nos colonies sont des endroits où l’on envoie les mauvais sujets pour les faire manger par les anthropophages » (Chambre des députés, 21 février 1911). Dix jours plus tard, le 2 mars, il devient ministre des Colonies (Cabinet Ernest Monis). Va-t-il appliquer ses idées ? Malheureusement, le Cabinet est très éphémère (il chute le 23 juin). Par la suite, Messimy s’en tient à son idée fixe. Seize ans après une première interpellation, il écrit au ministre de l’Instruction publique, Édouard Herriot : « L’ignorance de la plupart des Français en matière coloniale est l’un des plus grands obstacles qui s’opposent à la mise en œuvre des richesses latentes de nos possessions lointaines » (Le Temps, 24 janvier 1927). Il brosse ensuite un tableau désolé de la place des questions coloniales dans les programmes scolaires, puis demande au ministre quelles mesures il compte prendre pour remédier à ce fait.
Mais c’était peine, semble-t-il, perdue. En 1931, durant six mois pleins, plus de 8 millions de visiteurs firent le voyage de l’Exposition de Vincennes. Les tenants de la présence française aux colonnes exultaient : les Français avaient enfin l’esprit colonial ! Pas certain du tout, répliquait, réaliste, un journaliste spécialisé : « Au lendemain de Vincennes, le Français ne saura pas où c’est, mais il saura que ça existe » (Pierre Mille, 1931) .
La Chine citée parmi les colonies françaises
Du 21 novembre au 31 décembre 1949, l’INSEE procède à un sondage national d’une ampleur exceptionnelle (21 questions expédiées à 4.193 personnes tirées au sort dans 200 communes ; 3.000 réponses anonymes furent retenues), que l’on pourrait appeler la France profonde . Jamais enquête n’avait été menée, sur ces questions, de façon si approfondie, avec des méthodes modernes. L’enjeu était de taille : alors que se profilait une décolonisation à laquelle la France officielle tentait de résister par tous les moyens, il s’agissait de savoir 1/ ce que savaient ; 2/ ce que pensaient les Français de l’Empire.
Une modeste livraison, à couleur bistre-marron, du très officiel Bulletin mensuel de Statistique d’outre-mer, publication conjointe du Ministère des Finances et du Ministère de la France d’outre-mer, publia les résultats .
La première question du sondage de 1949 était toute simple : Pouvez-vous citer le nom de possessions françaises outre-mer ? On aurait pu penser que l’Algérie, les Antilles, La Réunion, départements, que l’Indochine, alors en guerre depuis trois ans, que la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire… étaient devenus des noms familiers aux oreilles des Français… Il n’en était rien. Deux sondés sur 10, précisément 19 %, ne pouvaient citer aucun nom ; une deuxième tranche de 19 % avançait un ou deux noms. À l’opposé, les bons élèves, capables d’après les sondeurs de citer cinq pays ou plus, n’étaient que 28 %. Parmi ces pays cités, l’Algérie arrivait cependant en tête, avec 39 % des sondés, devant le Maroc, 38 %, et l’Indochine, 35 %. Mais les DOM étaient particulièrement mal lotis : Martinique, 7 % ; Guadeloupe, Réunion, Guyane, 4 % -certains se réfugiant derrière un prudent Antilles (3 %). Les sondeurs ajoutaient, mi-amusés, mi-excédés, que la Corse, la Syrie-Liban, Haïti, le Siam, la Palestine et même… la Chine figuraient parmi les réponses. À une question plus difficile, l’estimation de la population totale des possessions françaises (alors Union française), un Français sur deux ne savait répondre, 14 % avançaient le chiffre slogan du Parti colonial : 100 millions.
Une remarque au passage : ces mêmes Français qui ignoraient globalement leur Empire… étaient plutôt satisfaits de son bilan. À la question : La France a-t-elle bien travaillé dans les Territoires d’outre-mer ?, presque la moitié, 45 %, répondaient positivement, 22 % répondaient : Cela dépend. Si l’on additionne les 45 % de Oui et ne serait-ce que la moitié des Ni oui-ni non, on parvient donc à une majorité absolue.
Ce sont les enfants de cette France-là que les gouvernants de la IVème République vont envoyer faire les guerres de décolonisation, en Indochine -où il n’y avait certes que des engagés- puis en Algérie. En 1957, un sondage est effectué auprès des jeunes soldats en partance, justement, pour ce second conflit. Diverses questions sont posées. À la première, « Combien y a-t-il de Français installés en Algérie ? », 70 % répondent par des chiffres variant entre 30 et 60.000. La seconde question porte sur la distance à parcourir entre Marseille, lieu d’embarquement, et Alger ; les réponses vont de 100 à 5.000 km, la moyenne des réponses se situant autour de 3.000 ; enfin, 15 à 20 % des recrues pensent que l’Algérie est au sud du Sahara…

Alger en 1939 (AFP)
La pagode d’Angkor dotée d’un minaret
Un livre entier ne suffirait sans doute pas pour relever tous les contre-sens, erreurs, approximations, concernant la géographie et l’histoire coloniales. Parfois, les auteurs étaient de simples et braves citoyens. D’autres fois, des responsables politiques, des intellectuels, des journalistes dirent ou écrivirent des bourdes plus difficilement excusables…
Curieux usage du mot Minaret dans une description de l’espace colonial de l’Exposition universelle de 1889 : « Près de là s’élève la pagode d’Angkor (…) ; le minaret a déjà ses longs anneaux d’or qui se détachent sur un fond pourpre » (L’Univers illustré, 27 avril 1889) .
Une scène contée par Alphonse Allais est certes sortie de l’imagination fertile de l’humoriste, mais elle n’est pas invraisemblable :
« Je me promenais dans la fête de Montmartre, quand une baraque attira mes regards. On y montrait, disait l’enseigne : “La belle Zim-laï-lah, la seule véritable Exotique de la Fête“. Dans la foule, une jeune femme du peuple, appuyée sur le bras d’un robuste travailleur, demanda à ce dernier :
De quel pays que c’est, les Exotiques ?
Les Exotiques ?… C’est du côté de l’Algérie, parbleu !… en tirant un peu sur la gauche.
La jeune femme du peuple jeta sur le vigoureux géographe un long regard où se lisait l’admiration » (Tickets, 1891).
Le robuste travailleur d’Allais est surpassé dans la confusion par un auditeur, interrogeant un conférencier (propos rapportés par celui-ci, outré) : « Vous allez en Tunisie, c’est tout près du Tonkin ? » (Eugène de Montureux, Voyage en Tunisie, 6 mars 1910) .
De la même façon, on peut s’interroger sur la maîtrise du vocabulaire géographique d’un auteur, écrivant pourtant dans une revue culturelle : « Le Maroc, avec l’Algérie, la Tunisie et la Tripolitaine, fait partie de cette Algérie septentrionale à laquelle le voisinage de la Méditerranée a donné de tout temps, et donne surtout, à notre époque, une si grande importance » (Max de Nantousy, Les Annales Politiques et Littéraires, 1er janvier 1911) .
La conquête de l’Algérie avec Roland au clairon
Attristé, effondré, un mensuel du pourtant actif lobby colonial constate : « Au dernier concours d’entrée à Saint-Maixent, le sujet choisi pour la composition d’histoire était : “L’expansion coloniale de la France au dix-neuvième siècle“. Les compositions furent, dit-on, assez ternes. Un candidat affirma que Saigon avait été conquise par le lieutenant de vaisseau Savorgnan de Brazza. Un autre ne craignit pas d’avancer que Jules Ferry, en 1815, envoya une mission pour découvrir le Canada. Pour un troisième, Cayenne est une grande île du Pacifique. Son voisin, d’ailleurs, écrivait qu’à la conquête du Mexique, lors de l’entrée triomphale des Français à Québec, le duc de Montcalm trouva une mort glorieuse. Enfin à propos de la conquête de l’Algérie, on a pu recueillir cette magnifique perle : “Le plus bel épisode de la conquête de l’Algérie, affirme un concurrent, est l’histoire touchante du clairon Roland qui, abandonné dans un défilé, sonna jusqu’à la mort pour appeler du secours contre les Infidèles“ » (Le Monde Colonial Illustré, octobre 1924).
Un comble de la confusion fut sans doute atteint avec la carrière de Joséphine Baker. Que cette native du Missouri, à l’accent américain prononcé, soit devenue tour à tour une Petite Tonkinoise (chanson de 1906 qu’elle reprit en 1930 pour lui assurer un succès universel), une négresse de la savane (J’ai deux amours), ou une petite sauvageonne tunisienne (film d’Edmond Gréville, Princesse Tam-Tam, 1935) est un signe qui ne trompe pas. Le comble fut sans doute atteint en 1931 avec son élection au titre de Reine des colonies, dont on ne sait s’il s’est agi d’un vrai projet, d’un canular ou d’un coup de publicité… « Des impresarios habiles ont promu Joséphine Baker reine des Colonies françaises. La nouvelle n’en a été connue par le commissariat général de l’Exposition que lorsque la presse l’a unanimement publiée. Cela a fait scandale. Allait-on laisser couronner du diadème colonial une grande artiste, certes, mais qui est née dans un faubourg de Saint-Louis, sur les rives du Mississipi ? L’alerte a été chaude. Enfin, la paix s’est faite lorsque les délégués officiels, envoyés par le gouverneur Olivier à l’étoile noire, ont reçu, d’elle-même, l’assurance qu’elle acceptait de renoncer à la couronne… » (Voilà, l’hebdomadaire du reportage, 2 mai 1931) . Le Canard enchaîné conta cet événement de façon plaisante : « À l’heure des discours, Melle Joséphine Baker, toute charmante dans sa parure de reine, tenant d’une main son sceptre d’or et de l’autre une plume de paon, a remercié en, termes de choix M. Auguste Sabatier et toute l’assistance pour le grand honneur qu’on lui faisait : “Moi y en avoir plaisir beaucoup avec missi Sabati. Moi lui apprendre danse du ventre et roulis-roulis et pilou-pilou et tout. Missi Sabati, grand députi, grand ministre, grand gentleman, grande intelligence, grand cerveau, missi Sabati. Aoh yes !“ » (Drégerin, Le Canard enchaîné, 11 mars 1931) .
Dans sa volonté de prouver à toute force que la métropole a toujours voulu abandonner l’Algérie, un écrivain pied-noir écrit : « Le maréchal Bugeaud (…) propose même à l’Empereur d’abandonner cette terre d’Algérie » (Raphaël Delpart, L’histoire des Pieds-Noirs d’Algérie, 2002) . Or, Bugeaud a été envoyé en Algérie par la Monarchie de juillet. Mort en 1849, il n’a pu, et pour cause, s’opposer à Napoléon III, parvenu sur le trône — de la façon que l’on sait — en 1851. Ce même Bugeaud, décidément bien mal traité par les apprentis historiens, est censé avoir dit au roi Charles X, en février 1848, qu’il mettait son sabre à sa disposition, « ce sabre dont il se servit à Isly, contre les Kroumirs » . Or, si le maréchal combattit bien à Isly, ce fut contre les Marocains, et non contre les Kroumirs, tribu tunisienne. Leurs incursions, qui servirent de prétexte à l’intervention française en Tunisie, datent de 1881, soit 32 années après la mort de Bugeaud.
Récit d’un voyage du général de Gaulle en province, au lendemain de la Libération. Le sultan du Maroc, décoré pour sa fidélité à la France durant l’occupation nazie, accompagnait le Général. Georges Pompidou, alors chargé de mission, se souvient : « J’eus la joie de parcourir avec lui mon Auvergne natale à travers laquelle nous promenions le sultan du Maroc et sa suite, dans laquelle se distinguait la figure d’aigle du Glaoui. Il me souvient d’un brave paysan du Cantal criant sur la parcours des notabilités marocaines : “Bravo les nègres !“, exclamation enthousiaste dont je doute pourtant qu’elle fût de nature à satisfaire qui que ce soit » (Pour rétablir une vérité, 1988).
Lors des négociations de La Celle Saint-Cloud, qui devaient préluder à l’indépendance du Maroc, un délégué marocain eut la surprise de s’entendre demander (anecdote rapportée par Raymond Dronne qui, par charité sans doute, ne donne pas le nom du délégué) : « Nous vous donnerons tout ce que vous voudrez, mais laissez-nous Bizerte » (novembre 1955) .
Emile Zola situe Tunis au Maroc
Zola ironise sur l’aventure d’un imposteur qui avait quelque temps défrayé la chronique en se présentant comme de sang royal marocain. Mais l’auteur confond manifestement Maroc et Tunisie… « Ce sieur Joly n’était point un imbécile. Il s’est fait prince héréditaire du Maroc, en homme qui savait que les princes poussent dans ce pays aussi nombreux que les épis des champs. Il y a, à Tunis, deux cents, trois cents princes héréditaires… » (Un prétendant au trône du Maroc, 1872) .
Dans un des contes d’Anatole France, son personnage principal, Louis Longuemare, semble confondre assez allègrement la Cochinchine (sud du Viêt Nam) et la région de Shangai… « C’est sur ma demande que je suis mis hors cadre et détaché comme stagiaire en Cochinchine (…). Je ne verrai plus le Boulevard St Michel. Je trouverai à Shangai des monuments ostéologiques d’après lesquels j’achèverai mon mémoire sur la dentition des races jaunes » (Jocaste, 1878).
En 1881, Maupassant fait, pour le quotidien Le Gaulois, un voyage en Algérie. Il envoie un article, prétendument rédigé par un « homme très considérable de l’Algérie, et qui l’habite depuis longtemps » (en fait, l’article état bien de la plume de l’écrivain). Or, ce vieux colonial écrit une phrase étrange : « J’ai vécu pendant des années au milieu des Arabes et surtout au milieu des Kabyles… » (Lettres d’Afrique, 1881) .
Et Paul Claudel pense que l’Egypte est en Asie
À la toute première ligne d’un de ses ouvrages, Paul Claudel semble bien situer l’Égypte en Asie… « L’Asie est le pays de ce qu’on appelle les Nations Ermites, telles que l’Égypte et la Mésopotamie nous en ont fourni les exemples les plus anciens… » (Sous le signe du dragon, vers 1904).
Son collègue Académicien André Maurois trouve que les jeunes Français n’ont pas assez le sens colonial. Il décide d’écrire un ouvrage de vulgarisation, magnifiquement illustré, dans une grande collection de chez Hachette. Hélas ! ses connaissances géographiques sont imprécises : « Au nord de l’Indochine, le Tonkin attirait l’attention des commerçants français parce que c’était là que se jetait, dans l’Océan Indien, le Fleuve Rouge… » (L’Empire français, 1939).

Des touristes sur le canal de Suez. Photo non datée. AFP
Même la haute administration ne connaît rien aux colonies
Le haut personnel politique métropolitain n’était, semble-t-il, pas toujours bien au fait des questions coloniales. En tout cas s’il faut en croire la remarque d’un Directeur de la Compagnie française de l’Afrique occidentale sur André Maginot, tout nouvellement nommé ministre des Colonies : « Bien entendu, il n’entend rien aux Colonies, ce qui ne le distingue d’ailleurs pas beaucoup de la plupart de ses prédécesseurs » (Frédéric Bohn, Lettre, 20 mars 1917).
Par contre, il convient de tordre le cou à une légende solidement ancrée. En 1905, Étienne Clémentel nouvellement nommé ministre des Colonies, aurait observé une carte, émaillé des fameuses taches roses, en arrivant dans son bureau , se serait écrié : « Les colonies, je ne savais pas qu’il y en eût tant ! ». Les historiens les plus sérieux ont parfois repris cette citation. On la retrouve même dans des sites spécialisés de révision du bac… Mais le doute vient lorsqu’on constate qu’elle n’est jamais référencée. Ce seraient les volontés réformatrices de ce ministre qui lui auraient attiré l’hostilité du lobby colon, à l’origine de cette rumeur .
« Ô vous Habitants d’Alger et de toutes les tribus marocaines »
Il fallait que l’ère de la Seconde colonisation fût inaugurée par une confusion significative… Ce fut chose faite avec la toute première proclamation du Comte de Bourmont, commandant en chef du Corps expéditionnaire en Algérie. Cette proclamation, rédigée en France en mai 1830, confond allègrement habitants de la régence d’Alger et Marocains : « Ô vous, les plus chers de nos sincères amis, habitants d’Alger et de toutes les tribus marocaines, dépendant de vous, sachez que le pacha votre chef a eu l’audace d’insulter le drapeau de la France (…). Tribus des Marocains, sachez bien et soyez pleinement convaincus que je ne viens pas pour vous faire la guerre… » (Comte de Bourmont, Proclamation, mai 1830) . Le rédacteur de la Revue Africaine, qui citait bien plus tard cette proclamation, accompagna cette approximation du commentaire suivant : « En se servant du mot “Mar’âriba“, le rédacteur de ce document a cru dire les “Maugrebins“, les habitants du Magreb, ignorant que dans l’usage vulgaire il se prend toujours pour désigner les Marocains ».
N’y a-t-il aucune ligne de chemin de fer qui traverse la Kabylie ?
Paul Bonnetain, une des plumes du Parti colonial, s’étouffait de rage en constatant que les futurs hussards noirs de la République ne connaissent pas le domaine ultramarin :
« On sait qu’on a fait appel aux instituteurs pour créer de nouvelles écoles en Kabylie. Les appointements doivent être de 3.000 francs. Alléché par ce chiffre, un instituteur du midi de la France a envoyé à un de ses parents habitant l’Algérie un questionnaire de dix-huit articles (!) parmi lesquels nous citerons les suivants :
Y a-t-il un bon nombre d’instituteurs dans la province de Kabylie ?
Les maisons d’école sont-elles construites ou à l’état de construction convenable, et les jardins spacieux ?
Les habitants sont-ils bien civilisés et quel est le chiffre des indigènes et des colons ?
Y a-t-il des routes et des chemins aussi nombreux qu’en France ?
L’eau est-elle abondante et potable ?
Le climat y est-il chaud, tempéré et sain ?
Les indigènes respectent-ils les lois du pays et n’ourdissent-ils pas des conspirations contre la France ?
Les tribus qui y sont établies ne veulent-elles pas faire partie de celles qui se sont insurgées ?
Le pays est-il montagneux, cultivé ou en friche ?
Y aurait-il moyen d’obtenir des concessions de terrain ?
Le nombre des médecins, pharmaciens, épiciers est-il proportionné à la population, comme en France, par exemple ?
N’y a-t-il pas d’animaux dangereux ?
Les marchands de meubles et ébénistes sont-ils nombreux ?
Le post-scriptum vaut son pesant d’or :
N’y a-t-il aucune ligne de chemin de fer qui traverse la Kabylie ?
Des tailleurs, y en a-t-il ?
Quand un instituteur chargé d’enseigner la géographie à des enfants français fait de pareilles questions sur l’Algérie, on devrait le renvoyer lui-même à l’école. Comment veut-on que l’Algérie soit connue du gros du public, quand un instituteur – vous lisez bien : un instituteur ! – fait preuve d’une aussi honteuse ignorance ? Et comment s’étonner après cela de l’indifférence de nos populations ouvrières et surtout rurales à l’endroit de notre colonie africaine ? » (Comment on connaît l’Algérie en France, 1881).
Il ne fallait pas compter sur la presse pour approfondir les connaissances : « Algérie-Tunisie. La population indigène est composée de Berbères ou Arabes, de Kabyles et de Maures » (Jean de Giafferri, L’Animateur des Temps nouveaux, 18 septembre 1931).
Les résultats inévitables étaient déplorés par Camus, de retour de son pays natal après le terrible drame de Sétif : « L’enquête que je rapporte d’un séjour de trois semaines en Algérie n’a d’autre ambition que de diminuer un peu l’incroyable ignorance de la métropole en ce qui concerne l’Afrique du Nord… » (Combat, 13 mai 1945) .
Le terreau était prêt pour que les exactions de la guerre d’Algérie se déroulent dans une indifférence de la majorité de l’opinion.
Mais où est la Cochinchine ?
En 1857, le Second Empire envisage la conquête de l’Annam (nom ancien du Viêt Nam). Le comte Walewski, ministre des Affaires étrangères, met en place une Commission chargée d’analyser la faisabilité du projet . Aucun des membres de la commission n’est allé dans la région, les seules informations provenant des missionnaires sur place. Aussi ne faut-il pas s’étonner des approximations géographiques des conclusions : « La Commission réunie au ministère des Affaires étrangères a proposé l’occupation des trois villes principales de la Cochinchine ou, pour s’exprimer d’une manière plus exacte, de l’Empire d’Annam qui se compose du royaume de la Cochinchine proprement dit, du royaume du Tonquin, du royaume du Cambodge et d’autres contrées moins importantes. Les trois villes qu’il s’agirait d’occuper sont : Hué, capitale du royaume de Cochinchine ; Ketcho, capitale du royaume du Tonquin ; Saïgon, capitale du royaume du Cambodge » (Rapport, mai 1857) . Fort de ces conclusions, pourtant, Walewski présente le projet à ses collègues : « J’ai parlé au Conseil des ministres de la Cochinchine, mais la question cochinchinoise n’a pas trouvé faveur auprès de mes collègues. Fould d’abord nous a dit qu’il ne savait pas où était la Cochinchine, ni ce que c’était… » (Lettre à Napoléon III, 16 juillet 1857) .
Lors de la chute de Saigon entre les mains françaises, un grand quotidien d’information explique à ses lecteurs où se situe cette ville : « Quelques détails sur la ville de Saïgon qui vient de tomber au pouvoir des Français, secondés par les Espagnols. Saïgon est la capitale du royaume de Camboge qui, avec le royaume du Tonquin et celui de la Cochinchine proprement dite, forme le vaste empire d’Annam. Le royaume de Camboge offre de grandes ressources par sa richesse et sa fertilité ; on le considère comme le grenier de la Cochinchine » (Le Journal des Débats, 18 avril 1859) .

Une rue de Saïgon en 1945 (AFP)
Le temps ne fait rien à l’affaire : « Allez donc demander à nos jeunes bacheliers l’histoire des motifs politiques et économiques qui ont conduit la France et l’Angleterre à créer des établissements en Asie. Combien seront capables de vous dire seulement quelques mots sur ce sujet. Ces matières n’entrent pas dans le programme du mémento (…). Pourtant, comme elle aurait été de tout temps nécessaire à notre jeunesse, cette connaissance de la chose coloniale qui eût pu nous éviter le rappel de Dupleix, les ligues anti-tonkinoises et l’ignorant pédantisme des adversaires actuels de notre Indo-Chine » (L’Avenir du Tonkin, août 1901) .
Lors de l’Exposition universelle de Paris, en 1900, une partie est consacrée aux colonies françaises. Un Guide, sous prétexte d’aider le public, doit singulièrement obscurcir les esprits : « Commençons la visite par la Section française. Rappelons que le Tonkin, le Cambodge et l’Indo-Chine sont décrits sous le titre général Indo-Chine. » (Paris-Exposition, 1900) .
La presse de métropole était régulièrement épinglée par les vrais connaisseurs de la région.
« On est stupéfait, quand on lit les journaux de cette époque (je parle de ceux généralement considérés comme bien renseignés), de l’ignorance où l’on était des choses de l’Extrême-Orient. On en ignore même la géographie ; c’est au point que dans l’un d’eux que j’ai sous les yeux, il est question de “M. Lao-kaï“. Je me rappelle qu’un jour un des ministres les plus remarquables de la III è République, auquel je parlais du Yun-nan, me demanda si le Yun-nan était une province annamite » (Jean Dupuis, Le Tonkin de 1872 à 1886, 1910) .
Ainsi cette notice nécrologique, relevée avec rage et ironie par Louis Bonnafontin qui signait souvent Le Nha Qué , confondant allègrement l’épidémie de fièvre dengue et une ville inventée : « M. Destenay, résident supérieur, secrétaire général intérimaire de l’Indo-Chine, malade à Dengué, depuis cinq jours, est mort avant-hier soir à Hanoï, à la suite d’une aggravation subite » (Le Figaro, 11 juin 1915) .
Compte-rendu d’une journée passée par Paul Reynaud, ministre des colonies, au Tonkin. Langson (ou Lang Son) est près de la frontière sino-vietnamienne : « Le dimanche 8 novembre, M. Reynaud alla jusqu’à Langson (…) tandis que quelques-uns de ceux qui accompagnaient le ministre poussèrent jusqu’à la Muraille de Chine » (Raymond Lestonnat, L’Illustration, 12 décembre 1931) … laquelle muraille, on le sait — ou on devrait le savoir — est à l’autre extrémité de la Chine, au nord de Pékin).
Il est vrai que sa collègue, une journaliste, avant de commencer une envolée lyrique sur la construction du Pont Doumer, raconte cette anecdote : « Au mois de mars 1897, Paul Doumer, nommé gouverneur général, arriva devant Hanoï. Il venait de Haïphong. Les voitures officielles n’avaient pu descendre au débarcadère battu par les eaux rougeâtres et troubles du Mékong » (Henriette Célarié, Promenades en Indochine, 1937) . Elle devait ignorer que c’est le Fleuve Rouge qui traverse Hanoi.
L’Indochine, le pays des bons sauvages
Aussi peut-on croire sur parole le grand érudit Louis Malleret lorsqu’il écrit : « Il manque à l’opinion française une éducation asiatique (…). En 1931, au moment où les foules affluent à Vincennes, on a pu lire dans de grands journaux que la prodigieuse cité d’Angkor appartient au Siam, qu’un cyclone a ravagé Poulo-Condore ”possession américaine“ et, sous des photographies représentant d’authentiques Cochinchinoises, trouver l’éloge de “belles Japonaises“ visitant l’Exposition (…). Aujourd’hui encore, il n’est pas sûr que les lecteurs français ne se représentent l’Indochine comme le pays des bons sauvages chers à Bernardin de Saint-Pierre, comme une contrée favorisée de tous les dons de la nature, aux arbres partout gigantesques, au ciel éclatant, au soleil magicien » (L’exotisme indochinois dans la littérature française, 1934) .
Dans son désir de prouver à toute force l’ampleur du dévouement des savants français outre-mer, un journaliste royaliste alla jusqu’à faire mourir prématurément le pauvre Yersin : « Beaucoup laissèrent leur existence dans cette entreprise. Yersin, par exemple, mourut de la peste dont il venait de découvrir le microbe » (Claude Quevenay, L’Action française, 10 août 1936) . Or, Yersin, bien que très âgé, était alors en parfaite santé. Il mourut de vieillesse et non de la peste, en 1943.
L’un des personnages d’Aragon se remémore ses sentiments d’enfance, au début du siècle : « Tiens, je repense au cousin Louis… Quand il était enfant, lui, c’est-à-dire avant qu’il vienne étudier à Paris, il habitait Haiphong, son père était dans les douanes. On recevait des cartes postales : “Bons baisers de Haiphong“… ou des vues de la baie d’Along pendant les vacances, moi, ce qui m’intéressait surtout, c’étaient les timbres-poste. Cela me paraissait absolument naturel que l’oncle fût dans les douanes à Haiphong, comme il avait été à Bellegarde, à la frontière suisse. L’lndo-Chine, nous disions l’lndo-Chine alors, cela devait ressembler à la Savoie… à part qu’on y cultivait surtout le riz, paraît-il. » (Blanche ou l’Oubli, 1967) .
Dans le même ordre d’idées, récit cocasse, par un diplomate cultivé, des bourdes d’un homme politique aux connaissances géographiques imprécises. « Signature à l’Elysée du traité avec le Laos (…). Le déjeuner qui suivit ne parut guère folâtre et la réception, ce soir, à Versailles, ne l’était pas non plus. Le personnage comique en fut notre hôte, M. Boisdon, Président de l’Assemblée de l’Union française. Notaire berrichon devenu speaker d’un parlement noir, blanc et jaune, il dissémina ses gaffes sur les continents asiatique et africain. Aujourd’hui, la langue ne cessait de lui fourcher. Il félicita le roi du Laos, d’abord de l’endurance de ses sujets annamites, puis de la beauté des montagnes du Cambodge… » (Jacques Dumaine, Journal, 19 juillet 1949) .

En Indochine, dans les rue de Hanoi en 1939. (AFP)
Il y a des cocotiers et des noirs réputés anthropophages
Remarque du Gouverneur de Nouvelle-Calédonie : « En France, une opinion publique très insuffisamment avertie de ce qu’est la Nouvelle-Calédonie (…) ignore à peu près tout de notre beau pays. On ne la connaît guère encore que sous le nom de “La Nouvelle“, et comme il y a des cocotiers et des noirs réputés anthropophages, on en fait quelque chose de semblable au Congo, mais infiniment plus petit sur la carte et par conséquent insignifiant » (Joseph Guyon, Rapport devant le Conseil général, Nouméa, 1925) .
Un archiviste français célèbre, qui a fait une partie de sa carrière à La Réunion, note avec humour : « Les Français de la métropole, peu instruits, ne s’y reconnaissent pas entre Mascareigne, La Réunion, Bourbon et l’île Bonaparte, auxquelles ils mélangent encore Maurice et l’île de France, n’ayant qu’une idée précise à propos de toutes ces îles, c’est qu’elles font sûrement partie des Antilles… » (Yves Pérotin, Chroniques de Bourbon, 1957) .
Même constatation désabusée sous la plume d’André Blanchet, reporter au Monde, à propos de La Réunion : « Paris ne semble pas s’intéresser aux affaires courantes de ce département sans doute trop lointain -si lointain que bon nombre de fonctionnaires ne sauront jamais le localiser sur la mappemonde. Ignorée géographiquement, La Réunion reçoit souvent son courrier administratif “via New York“, sans doute parce qu’on la croit une des Antilles » (André Blanchet, Le Monde, 27 janvier 1949) .
Conclusion désabusée d’un observateur des réalités post-coloniales dans les DOM-TOM, inventeur par ailleurs de l’expression Confettis de l’Empire : « L’indifférence de l’opinion “éclairée“ à l’égard de nos poussières d’empire a été dénoncée ici. Au niveau de l’homme de la rue, elle confine à l’ignorance la plus épaisse. Le Français moyen, celui du métro, de l’épicerie, de la terrasse de café, manifeste une sorte de “bon sens“ instinctif. Pour lui, les choses sont désormais assez simples : depuis longtemps, la France n’a plus de colonies. Voilà tout. Spontanément il considérera n’importe quel Noir croisé dans la rue comme le citoyen d’un jeune État indépendant (…). “Partout où je vais, nous disait un jeune intellectuel de Cayenne, à la poste, à la gare et même dans les administrations, on me demande souvent mon passeport quand je dis que je suis guyanais. Lorsque je réponds que la Guyane est encore un département français, on me regarde avec une pointe de suspicion“. Le même genre de mésaventures arrive quotidiennement aux Antillais ou aux Réunionnais » (Jean-Claude Guillebaud, Les confettis de l’Empire, 1976) .
*Alain Ruscio, 71 ans, est historien, spécialiste de la période coloniale. Il a publié de nombreux ouvrages, dont « Nostalgérie. L’interminable histoire de l’OAS » (La Découverte, 2015) et travaille actuellement à la coordination d’une « Encyclopédie de la colonisation française » (Les Indes Savantes), dont les deux premiers volumes sont déjà parus. En février, il publiera à La Découverte : « Les communistes et l’Algérie, des origines à la guerre d’indépendance, 1920-1962 ».
 A 66 ans, Christiane Taubira est en retrait de la vie politique. Sous la présidence de François Hollande, elle a mené la bataille du mariage pour tous à l’Assemblée nationale en 2012 comme garde des sceaux. Femme de lettres, ses discours sont toujours ponctués de citations littéraires ou philosophiques. Son dernier ouvrage « Baroque sarabande » (Philippe Rey, 173 p., 9,50 euros) revient sur les livres qui ont compté pour elle, de son enfance en Guyane, dont elle fut députée durant dix-neuf ans, jusqu’à aujourd’hui. Interrogée sur une chanson qui a marqué sa vie, Christiane Taubira a écrit le texte suivant.
A 66 ans, Christiane Taubira est en retrait de la vie politique. Sous la présidence de François Hollande, elle a mené la bataille du mariage pour tous à l’Assemblée nationale en 2012 comme garde des sceaux. Femme de lettres, ses discours sont toujours ponctués de citations littéraires ou philosophiques. Son dernier ouvrage « Baroque sarabande » (Philippe Rey, 173 p., 9,50 euros) revient sur les livres qui ont compté pour elle, de son enfance en Guyane, dont elle fut députée durant dix-neuf ans, jusqu’à aujourd’hui. Interrogée sur une chanson qui a marqué sa vie, Christiane Taubira a écrit le texte suivant. ombres et des ivresses, je suis bronze de Giacometti, fine et incurvée, granuleuse, le regard égaré, pas pour de vrai mais bronze tout de même, « l’alliage du sang fort qui gicle quand souffle le vent des marées saillantes ». C’est ce que croit Tchicaya U Tam’si.
ombres et des ivresses, je suis bronze de Giacometti, fine et incurvée, granuleuse, le regard égaré, pas pour de vrai mais bronze tout de même, « l’alliage du sang fort qui gicle quand souffle le vent des marées saillantes ». C’est ce que croit Tchicaya U Tam’si.
 César de la meilleure actrice en 2003 pour son rôle dans Se souvenir des belles choses, de Zabou Breitman, Molière de la meilleure comédienne en 1999 et 2004, cette comédienne subtile a publié en janvier un premier roman remarqué, Les Rêveurs (Grasset). « L’actrice connue que personne ne connaît », comme elle se définit elle-même, y dévoile, à petites touches, son enfance particulière, entre une mère fragile et un père homosexuel.
César de la meilleure actrice en 2003 pour son rôle dans Se souvenir des belles choses, de Zabou Breitman, Molière de la meilleure comédienne en 1999 et 2004, cette comédienne subtile a publié en janvier un premier roman remarqué, Les Rêveurs (Grasset). « L’actrice connue que personne ne connaît », comme elle se définit elle-même, y dévoile, à petites touches, son enfance particulière, entre une mère fragile et un père homosexuel. En arrivant à Jökulsarlon, un somptueux glacier se déversant dans la mer, j’ai découvert que le site était interdit, mais All is Full of Love, n’est-ce pas ? En bonne Française, je n’en ai pas tenu compte et j’ai franchi les barrières. Un tournage de James Bond était la cause de ce blocage. J’ai continué de marcher dans ce désert blanc, émerveillée, « Twist your head around/It’s all around you »… Jusqu’à ce qu’une quinzaine d’assistants et un hélicoptère se jettent sur moi : « Vous êtes dans le plan ! Partez ! Vous êtes dans le champ ! » Et voilà comment j’ai joué dans Meurs un autre jour, à cause d’une chanson. Après Ursula Andress, mais bien avant Léa Seydoux, je rejoignais – sans casting ! – le club très envié des James Bond Girls… Le petit point noir au milieu de ce paysage immaculé, c’était moi !
En arrivant à Jökulsarlon, un somptueux glacier se déversant dans la mer, j’ai découvert que le site était interdit, mais All is Full of Love, n’est-ce pas ? En bonne Française, je n’en ai pas tenu compte et j’ai franchi les barrières. Un tournage de James Bond était la cause de ce blocage. J’ai continué de marcher dans ce désert blanc, émerveillée, « Twist your head around/It’s all around you »… Jusqu’à ce qu’une quinzaine d’assistants et un hélicoptère se jettent sur moi : « Vous êtes dans le plan ! Partez ! Vous êtes dans le champ ! » Et voilà comment j’ai joué dans Meurs un autre jour, à cause d’une chanson. Après Ursula Andress, mais bien avant Léa Seydoux, je rejoignais – sans casting ! – le club très envié des James Bond Girls… Le petit point noir au milieu de ce paysage immaculé, c’était moi !

 Bernard de Clairvaux. Gravure (colorisée) de 1584
Bernard de Clairvaux. Gravure (colorisée) de 1584


 Michel Duclos
Michel Duclos









 “Grief is a force of energy that cannot be controlled or predicted. It comes and goes on its own schedule. Grief does not obey your plans, or your wishes. Grief will do whatever it wants to you, whenever it wants to. In that regard, Grief has a lot in common with Love.”
“Grief is a force of energy that cannot be controlled or predicted. It comes and goes on its own schedule. Grief does not obey your plans, or your wishes. Grief will do whatever it wants to you, whenever it wants to. In that regard, Grief has a lot in common with Love.”










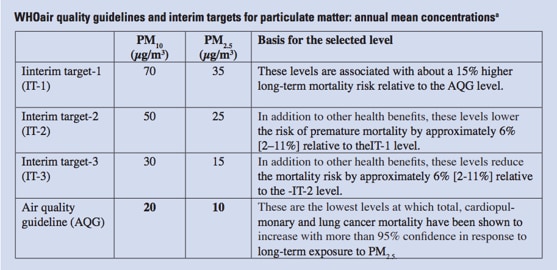

































 love,” artist Louise Bourgeois wrote in her diary at the end of a long and illustrious life as she contemplated how solitude enriches creative work. It’s a lovely sentiment, but as empowering as it may be to those willing to embrace solitude, it can be tremendously lonesome-making to those for whom loneliness has contracted the space of trust and love into a suffocating penitentiary. For if in solitude, as Wendell Berry memorably wrote, “one’s inner voices become audible [and] one responds more clearly to other lives,” in loneliness one’s inner scream becomes deafening, deadening, severing any thread of connection to other lives.
love,” artist Louise Bourgeois wrote in her diary at the end of a long and illustrious life as she contemplated how solitude enriches creative work. It’s a lovely sentiment, but as empowering as it may be to those willing to embrace solitude, it can be tremendously lonesome-making to those for whom loneliness has contracted the space of trust and love into a suffocating penitentiary. For if in solitude, as Wendell Berry memorably wrote, “one’s inner voices become audible [and] one responds more clearly to other lives,” in loneliness one’s inner scream becomes deafening, deadening, severing any thread of connection to other lives.





