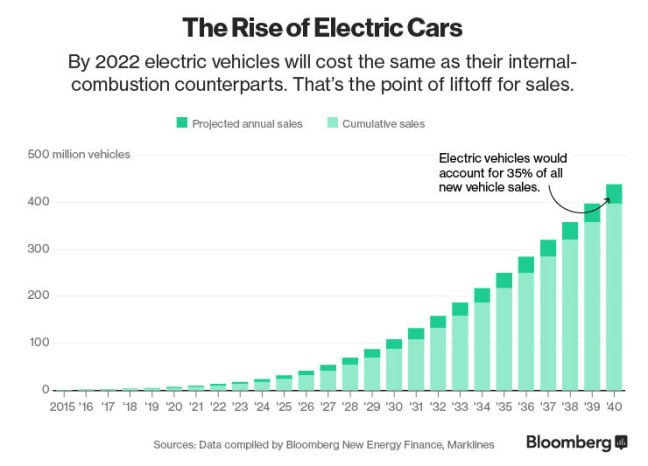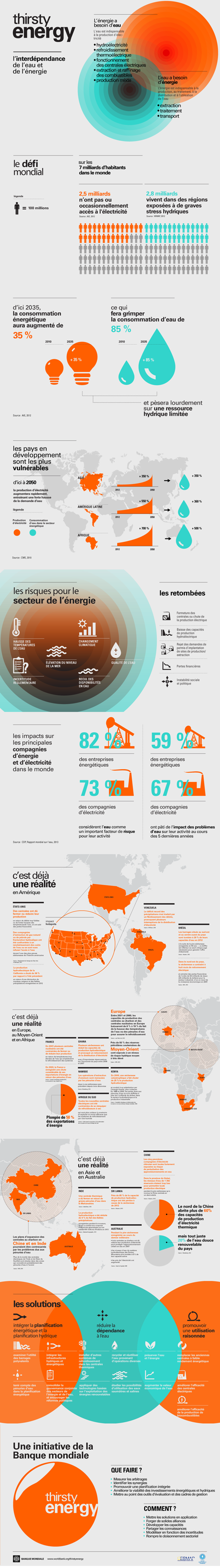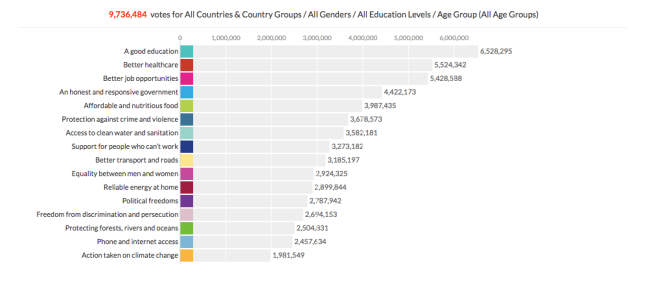En 1719, l’écrivain britannique Daniel Defoe donne naissance au personnage de Robinson Crusoé. Voyageur anglais, celui-ci fait naufrage sur une île située à l’embouchure de l’Orénoque, au Venezuela. Pour l’économiste Stephen Hymer, la vie qu’il se compose alors — chasse, agriculture et soumission de l’autochtone Vendredi — constitue une parfaite allégorie du mécanisme qui fonde le mode de production capitaliste : l’accumulation primitive.
Le personnage solitaire de Robinson Crusoé a souvent inspiré les économistes : par ses qualités de robustesse, d’efficacité, d’intelligence et de frugalité, il incarnerait la capacité de l’espèce humaine à maîtriser la nature. L’épopée que raconte Daniel Defoe est pourtant également une histoire de conquête, d’esclavage, de prédation, de meurtre. Bref, de loi du plus fort. Que cet aspect-là du roman soit généralement occulté ne devrait pas nous surprendre puisque, comme l’observait Karl Marx, « dans les manuels béats de l’économie politique, c’est l’idylle (…) qui a de tout temps régné (1) ». Entre le Robinson Crusoé chéri par les économistes et celui du livre, il y a un gouffre aussi large qu’entre le libre-échange tel que l’enjolivent les manuels d’économie et sa réalité factuelle.
La théorie libérale du libre-échange repose sur le modèle du chasseur et du pêcheur qui s’échangent mutuellement les fruits de leur labeur, dans un lien spontané d’égalité, de réciprocité et de liberté. Or le commerce international – ou interrégional – s’exerce le plus souvent dans un rapport de subordination, et dans des conditions qui sont tout sauf pacifiques. C’est le commerce entre la métropole et l’arrière-pays, le colonisateur et le colonisé, le maître et le domestique. De même que le capital a besoin du travail pour prospérer, le commerce repose sur une répartition bien ordonnée des tâches : aux uns la conception, la planification, l’organisation, le profit ; aux autres, le travail. C’est parce qu’il est intrinsèquement inégalitaire dans sa structure et dans la répartition de ses bénéfices qu’il s’instaure et se maintient par la violence, qu’elle soit sociale (la pauvreté), symbolique (la socialisation contrainte) ou physique (la guerre).
Le processus d’accumulation capitaliste s’enclenche à partir de la rencontre de deux catégories de personnes : d’un côté, les détenteurs d’argent, désireux d’accroître leur capital en achetant à autrui sa force de travail ; de l’autre, ceux qui n’ont que leur force de travail. Une fois en marche, le capitalisme maintient cette séparation et la reproduit à une échelle toujours plus vaste. Mais, avant qu’il se dresse sur ses jambes, il doit d’abord prendre forme et donc en passer par une période d’accumulation primitive.
Dans la dernière partie du premier volume du Capital, Marx analyse le processus historique qui a conduit à la concentration des moyens de production dans les mains du capital et à son emprise sur les travailleurs. Il montre comment le travail salarié s’est propagé progressivement, par l’expropriation des populations agricoles, et explique en partie la genèse du capitalisme industriel par le pillage de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique « dans l’aube rosâtre de l’ère capitaliste » .
Dans Robinson Crusoé, Defoe illustre cet avènement à travers le personnage d’un Anglais du XVIIe siècle qui amasse du capital grâce au labeur de ceux qui travaillent dans sa plantation brésilienne d’abord, sur son île caribéenne ensuite. Bien sûr, le système mis en place par Robinson n’est pas une économie de marché telle celle qui émergera plus tard en Angleterre, mais une économie agricole et coloniale telle que la pratiquaient les premiers capitalistes dans le monde non européen. En ce sens, l’histoire de Robinson est aussi celle du sous-développement primitif.
Du personnage, on a gardé le mythe du rescapé ingénieux ne comptant que sur lui-même pour survivre, alors que, dans le roman, il apparaît au contraire comme étroitement dépendant d’un groupe plus large. Même après son naufrage, Robinson reste tributaire de l’aide et de la coopération d’autrui. Son aventure souligne donc la nature profondément sociale de toute production. Rien de paradoxal à cela : la production de l’individu isolé relève du capitalisme tout autant que celle du groupe de travailleurs socialement organisés.
A la fin du livre, Robinson a accumulé plus de richesses qu’il ne rêvait d’en posséder avant son naufrage. A la fortune de sa plantation brésilienne, soigneusement entretenue et valorisée en son absence, s’ajoutent les ressources abondantes que lui procure le système économique qu’il met en place sur « son » île. Certes, il a subi une longue période de solitude, mais celle-ci, rétrospectivement, ne paraît guère plus insupportable que l’aliénation capitaliste endurée par tous – aussi bien ceux qui travaillent pour une rémunération minuscule que ceux, comme Robinson, qui accumulent et accumulent encore, sans jamais pouvoir s’arrêter.
Durant ses années de solitude, et au mépris de la théorie économique dominante, Robinson exploite l’île pour son usage personnel, et non pour l’échange. Il découvre qu’il ne souffre d’aucune pénurie, raison pour laquelle le travail perd peu à peu toute valeur à ses yeux quand il est seul. La passion de l’accumulation, force motrice du capitalisme, disparaît. Faute de personnes à administrer et à dominer, la cupidité de Robinson s’estompe. Pour Marx, c’est la plus-value prélevée sur le travailleur qui fait la prospérité du capitaliste. Qu’on lui retire sa main-d’œuvre, et son système de valeurs s’effondre du même coup. Plus de chasse effrénée aux plus-values, l’économie de subsistance de Robinson se suffit à elle-même. Les critères d’efficacité, de performance et d’accumulation se sont fondus dans un système de valeurs plus large.
Mais dès que Robinson sort de sa solitude, son désir de contrôle et d’accumulation reprend le dessus. Ce n’est que lorsqu’il n’exploite que sa propre force de travail qu’il cesse de mesurer les choses en termes de travail. L’argent et le capital sont des relations sociales fondées sur le pouvoir. Indépendamment de ce que ressentent les capitalistes lorsqu’ils contemplent leurs stocks, c’est du pouvoir sur autrui qu’ils comptent et thésaurisent – ils s’en apercevraient certainement si, comme Robinson, ils se retrouvaient tout seuls.
A travers son personnage, Defoe ne met pas seulement en scène l’aventure d’un héros échoué par accident sur une île déserte, mais également une allégorie sur la vie des hommes en régime capitaliste : une vie faite de solitude, de dénuement, d’incertitude et de peur. L’isolement de Robinson s’avère plus tenace dans son esprit qu’il ne l’est en réalité. Chaque fois en effet qu’il se retrouve en présence d’un visiteur, il réagit avec inquiétude et suspicion. Sa méfiance instinctive illustre parfaitement l’aliénation de l’individualisme possessif, qui se concrétise de nos jours par la multiplication de résidences privées accueillantes comme des bunkers.
Robinson possède un fusil, mais ce n’est pas par la force qu’il convainc Vendredi de devenir productif. Pour que le serviteur accepte sa position d’infériorité, le maître doit apprendre à l’amadouer. Robinson dispose à cet égard d’un avantage déterminant, puisqu’il a sauvé la vie de son compagnon ; néanmoins il doit œuvrer avec prudence, en suivant un programme en plusieurs étapes, pour que l’autochtone intériorise pleinement les liens de subordination tissés par son maître et agisse en subalterne consentant et « libre ».
Du jour où Robinson découvre une empreinte de pied dans le sable jusqu’à sa rencontre avec Vendredi, presque dix années s’écoulent. Dix années de peur, d’anxiété et de vigilance, durant lesquelles notre héros réduit considérablement ses activités productives et ose à peine glisser un pied hors de sa forteresse. Quand Vendredi débarque enfin dans sa vie, il peut à nouveau déployer son génie industrieux, entreprendre, construire, accumuler. Le récit ne précise pas si Robinson tient une comptabilité, mais il ne fait aucun doute que le travail, pour lui, a retrouvé sa pleine valeur : des objectifs sont fixés, des ordres donnés, des résultats attendus. Robinson assigne à Vendredi toutes sortes de tâches, il lui explique comment faire, le sermonne, l’encourage, le gronde, lui explique encore, etc. Grâce à son serviteur, il redevient un Homo economicus. A Vendredi le travail, à Robinson le capital, c’est-à-dire l’innovation, l’organisation et la constitution d’un empire.
La période de l’accumulation primitive s’achève. Robinson est désormais à la tête d’une grande propriété, acquise non grâce à la qualité du travail fourni par le passé, mais grâce à sa possession chanceuse d’armes à feu. Malgré tout le sang versé pour la constitution de son capital, celui-ci ne fait l’objet d’aucune contestation. Vendredi a travaillé durement, il ne s’est jamais vautré dans la paresse ou la débauche, et pourtant, au terme de sa corvée, il ne possède rien. Pendant que Robinson jouit dans l’oisiveté d’une fortune qui continue de croître inexorablement, son serviteur reste aussi pauvre qu’auparavant.
Petit à petit, d’autres personnes débarquent sur l’île. Avec opportunisme, le maître des lieux tire alors avantage de son monopole sur les moyens de production insulaires pour dicter sa loi aux nouveaux arrivants. Évidemment, au fur et à mesure que son empire s’étend, les problèmes qu’il rencontre deviennent plus épineux, mais Robinson ne manque pas de ressources pour les surmonter, usant tour à tour de la terreur, de la religion, de l’inviolabilité des frontières ou du principe de délégation de l’autorité royale pour consolider sa position et exercer un ordre autoreproducteur.
L’allégorie de Robinson Crusoé nous en apprend plus sur l’économie, son histoire et sa théorie que les contes pour enfants récités par la plupart des économistes modernes. Leur obsession pour le marché et les prix permet sans doute d’évaluer la valeur des habits du héros en fonction du volume de cannes à sucre récoltées sur sa plantation brésilienne, mais elle ne nous renseigne en rien sur la relation de Robinson et de Vendredi. Pour comprendre comment le capital se constitue et s’exerce, il est préférable de quitter la sphère tapageuse du marché, où tout se déroule en surface, et de s’immerger dans les tréfonds cachés du monde de l’entreprise.
Le capitaliste dépeint par Defoe s’échoue sur une île déserte située hors du marché, mais pas hors du monde. Une île où le capital apparaît dans sa nudité originelle : imposé par la force et l’illusion, accru grâce au travail d’autrui. Le certificat de naissance du capital de Robinson n’est pas aussi sanglant que celui des grosses fortunes marchandes, mais sa nature coercitive n’en est pas moins spectaculaire.