
Le Rapport sur le développement dans le monde 2018 appelle à mettre davantage l’accent sur les évaluations et à fonder l’action sur des données factuelles
Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, des millions de jeunes élèves courent le risque de rater des opportunités et de percevoir de bas salaires plus tard dans la vie parce que leurs écoles primaires et secondaires ne parviennent pas à leur donner l’éducation dont ils ont besoin pour réussir. Mettant en garde contre une « crise de l’apprentissage » dans l’éducation mondiale, un nouveau rapport de la Banque mondiale soutient que sans apprentissage, la scolarisation n’est pas seulement une occasion manquée, elle est également une grosse injustice pour les enfants et les jeunes du monde entier.
Le Rapport sur le développement dans le monde 2018 : « Apprendre pour réaliser la promesse de l’éducation » (ou WDR 2018) fait valoir que sans apprentissage, l’éducation ne pourra pas réaliser sa promesse d’élimination de la pauvreté et de promotion des mêmes chances et d’une prospérité partagée pour tous. Même après avoir passé plusieurs années sur les bancs de l’école, des millions d’enfants ne peuvent ni lire, ni écrire, ni effectuer des opérations de mathématiques élémentaires. Cette crise de l’apprentissage élargit les disparités sociales au lieu de les rétrécir. Les jeunes élèves déjà défavorisés par la pauvreté, les conflits, leur genre ou un handicap entrent dans la vie adulte sans avoir acquis ne seraient-ce que les compétences de base.
Pour le président du Groupe de la Banque mondiale Jim Yong Kim, « cette crise de l’apprentissage est d’ordre moral et économique. Lorsqu’elle est fournie de manière satisfaisante, l’éducation fait entrevoir la perspective d’un emploi, de meilleurs revenus et d’une existence en bonne santé et à l’abri de la pauvreté pour les jeunes. Pour la communauté, elle stimule l’innovation, renforce les institutions et consolide la cohésion sociale. Mais ces bienfaits dépendent des connaissances acquises ; et sans apprentissage, la scolarisation est une occasion manquée. Pire encore, elle est une grosse injustice : les enfants les plus défavorisés de la société sont ceux qui ont le plus besoin d’une bonne éducation pour réussir dans la vie ».
Le rapport recommande des mesures concrètes pour aider les pays en développement à résoudre cette terrible crise de l’apprentissage en renforçant les évaluations des acquis scolaires ; en s’appuyant sur les données concernant ce qui marche et ce qui ne marche pas pour orienter les décisions dans le domaine de l’éducation ; et en impulsant une forte dynamique sociale dans le but de susciter une réforme visant à mettre l’objectif « d’apprentissage pour tous » au centre de l’éducation.
Selon le rapport, lorsqu’on a demandé récemment à des élèves de troisième année du primaire au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda de lire en anglais ou en swahili une phrase du genre « le nom du chien est Fido », trois quarts n’ont pas compris ce que cela voulait dire. Dans les campagnes indiennes, près de trois quarts des élèves de troisième année du primaire n’ont pas pu faire une opération de soustraction à deux chiffres comme dans « 46 – 17 ». En cinquième année du primaire, la moitié en était toujours incapable. Bien que les compétences des Brésiliens âgés de 15 ans se soient améliorées, vu leur rythme actuel d’évolution, ils n’atteindront pas la note moyenne en mathématiques des pays riches avant 75 ans, et il leur faudra 263 ans pour la lecture.
Encore que ces chiffres ne tiennent pas compte des 260 millions d’enfants qui, du fait de conflits, de discriminations, de handicaps et d’autres obstacles, ne sont inscrits ni dans le primaire ni dans le secondaire.
Bien que tous les pays en développement n’affichent pas des résultats aussi déprimants, beaucoup sont largement à la traine de ce qu’ils ambitionnent. Des évaluations internationales de référence en matière de lecture, de calcul et d’écriture révèlent que les notes de l’élève moyen d’un pays pauvre sont inférieures à celles de 95 % des élèves de pays à revenu élevé — ce qui signifie qu’un tel élève serait admis à un programme de remise à niveau dans un pays à revenu élevé. De nombreux élèves affichant d’excellentes performances dans certains pays à revenu intermédiaire — garçons et filles se classant dans le quartile supérieur de leur cohorte — se retrouveraient dans le quartile inférieur des élèves d’un pays plus riche.
Rédigé par une équipe dirigée par Deon Filmer et Halsey Rogers, économistes principaux à la Banque mondiale, ce rapport pointe les éléments déterminants du déficit d’apprentissage en faisant ressortir non seulement les manifestations de la rupture entre l’enseignement et l’apprentissage dans un trop grand nombre d’établissements scolaires, mais aussi les facteurs politiques plus profonds qui font perdurer cette situation.
Il est possible de réaliser des progrès importants
Le rapport révèle que lorsque « l’apprentissage pour tous » devient une priorité pour les pays et leurs dirigeants, on peut améliorer considérablement les normes en matière d’éducation. À titre d’illustration, la Corée du Sud est parvenue en 1995 à une scolarisation universelle dans un système d’enseignement de qualité jusqu’au secondaire – ses jeunes étant classés au plus haut niveau par les évaluations internationales des performances scolaires – alors qu’elle était déchirée par la guerre et avait un très faible taux d’alphabétisation au début des années 50. Les résultats du Viet Nam à un test de suivi des acquis des élèves du second cycle du secondaire en mathématiques, science et lecture de l’OCDE (dénommé PISA) réalisé en 2012 ont montré que ses jeunes de 15 ans avaient le même niveau que ceux d’Allemagne, alors même que le Viet Nam est un pays nettement plus pauvre.
Grâce à une action concertée des pouvoirs publics, le Pérou a enregistré l’un des taux de croissance les plus rapides des résultats scolaires globaux entre 2009 et 2015. Dans plusieurs pays comme le Libéria, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tonga, la lecture dans les premières classes du primaire s’est considérablement améliorée en un temps record moyennant des actions ciblées reposant sur des données factuelles et des preuves solides.
« Le seul moyen de faire des progrès est de “rechercher la vérité à partir des faits”. Si nous nous y employons, nous trouverons que les faits concernant l’éducation révèlent une triste réalité. Pour un trop grand nombre d’enfants, scolarisation n’est pas synonyme d’apprentissage », déclare l’économiste en chef de la Banque mondiale, Paul Romer.
S’appuyant sur des données factuelles et des conseils recueillis durant des consultations approfondies menées dans 20 pays et associant des représentants de l’administration, d’organismes d’aide au développement, d’instituts de recherche, d’OSC et du secteur privé, le rapport énonce trois approches stratégiques :
Premièrement : apprécier les acquis pour faire de l’apprentissage un objectif sérieux.
Seule la moitié des pays dispose de critères d’appréciation permettant d’évaluer les acquis à la fin du primaire et du premier cycle du secondaire. Des évaluations bien conçues peuvent aider les enseignants à orienter les élèves, améliorer la gestion du système et amener la société à s’intéresser à l’apprentissage. Ces évaluations sont de nature à éclairer les choix stratégiques, mesurer les progrès et identifier les enfants à la traine.
Deuxièmement : mettre l’école au service de l’ensemble des apprenants.
Uniformiser les règles du jeu en réduisant le retard de croissance et en favorisant le développement des fonctions cérébrales par la nutrition et la stimulation précoces afin que les enfants soient disposés à apprendre au moment où ils commencent l’école. Attirer des talents dans l’enseignement et entretenir leur motivation en offrant aux enseignants une formation adaptée qui est renforcée par le concours de mentors. Déployer des technologies qui permettent aux enseignants d’enseigner en tenant compte du niveau de l’élève et renforcer les capacités de gestion des établissements scolaires, notamment celles des directeurs d’école.
Troisièmement, mobiliser tous ceux qui ont un intérêt dans l’apprentissage.
Recourir à l’information et aux indicateurs pour mobiliser les citoyens, accroître l’éthique de responsabilité et créer une volonté politique en faveur de la réforme de l’éducation. Associer les parties concernées, y compris les milieux d’affaires, à toutes les étapes de la réforme, de sa conception à sa mise en œuvre.
« Les pays en développement sont loin du niveau auquel ils devraient se trouver en matière d’apprentissage. Beaucoup n’y consacrent pas suffisamment de moyens financiers, et la majeure partie doit investir plus efficacement. Mais il ne s’agit pas simplement d’argent : les pays doivent aussi investir dans les capacités des institutions et des individus chargés d’éduquer nos enfants », affirme Jaime Saavedra, un ancien ministre de l’Éducation au Pérou désormais directeur principal pour l’éducation à la Banque mondiale. « Une réforme de l’éducation est nécessaire d’urgence et demande de la persévérance et un alignement politique de la part des pouvoirs publics, des médias, des entrepreneurs, des enseignants, des parents et des élèves. Tous doivent valoriser et exiger un apprentissage de meilleure qualité. »




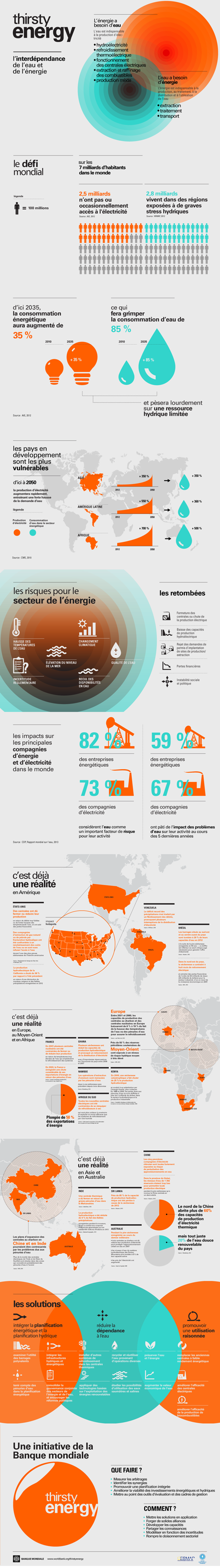




 contractés dans le secret par les plus hautes instances du pays. La dissimulation très maladroite de ces emprunts a provoqué un scandale international et conduit le pays dans une crise financière du fait du brutal surendettement entraînant des réactions/sanctions immédiates du marché et des bailleurs. Derrière les entreprises publiques de droit privé ayant contracté ces emprunts, un même responsable : le Gestão de Investimentos, Participações e Serviços (GIPS), une émanation des renseignements mozambicains (SISE), dont la supervision revient au ministère de l’Intérieur. Ce scandale révèle les dessous du succès économique mozambicain : des privatisations opaques profitant à nombre de dignitaires du régime, tolérées par les institutions de
contractés dans le secret par les plus hautes instances du pays. La dissimulation très maladroite de ces emprunts a provoqué un scandale international et conduit le pays dans une crise financière du fait du brutal surendettement entraînant des réactions/sanctions immédiates du marché et des bailleurs. Derrière les entreprises publiques de droit privé ayant contracté ces emprunts, un même responsable : le Gestão de Investimentos, Participações e Serviços (GIPS), une émanation des renseignements mozambicains (SISE), dont la supervision revient au ministère de l’Intérieur. Ce scandale révèle les dessous du succès économique mozambicain : des privatisations opaques profitant à nombre de dignitaires du régime, tolérées par les institutions de Bretton Woods. Ainsi, en 1996, lorsqu’il était gouverneur de la Banque centrale, l’actuel ministre de l’Économie et des Finances, Adriano Maleiane, dubitatif quant à la privatisation des deux banques d’État, s’était vu répondre par les émissaires de la Banque mondiale et du FMI qu’une privatisation corrompue valait mieux que l’étatisation. L’acceptation habituelle des dérives financières de l’establishment mozambicain a fini par le rendre trop confiant et l’a conduit à un montage financier qui remet en cause le modèle de croissance de son économie.
Bretton Woods. Ainsi, en 1996, lorsqu’il était gouverneur de la Banque centrale, l’actuel ministre de l’Économie et des Finances, Adriano Maleiane, dubitatif quant à la privatisation des deux banques d’État, s’était vu répondre par les émissaires de la Banque mondiale et du FMI qu’une privatisation corrompue valait mieux que l’étatisation. L’acceptation habituelle des dérives financières de l’establishment mozambicain a fini par le rendre trop confiant et l’a conduit à un montage financier qui remet en cause le modèle de croissance de son économie. continent africain. Il est entouré par l’Afrique du Sud, le Swaziland, Madagascar, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi et la Tanzanie. C’est une ancienne colonie portugaise, le premier pays lusophone d’Afrique (devant l’Angola) par sa population et le deuxième par sa superficie. Le pays est membre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et du Commonwealth of Nations.
continent africain. Il est entouré par l’Afrique du Sud, le Swaziland, Madagascar, le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi et la Tanzanie. C’est une ancienne colonie portugaise, le premier pays lusophone d’Afrique (devant l’Angola) par sa population et le deuxième par sa superficie. Le pays est membre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et du Commonwealth of Nations.